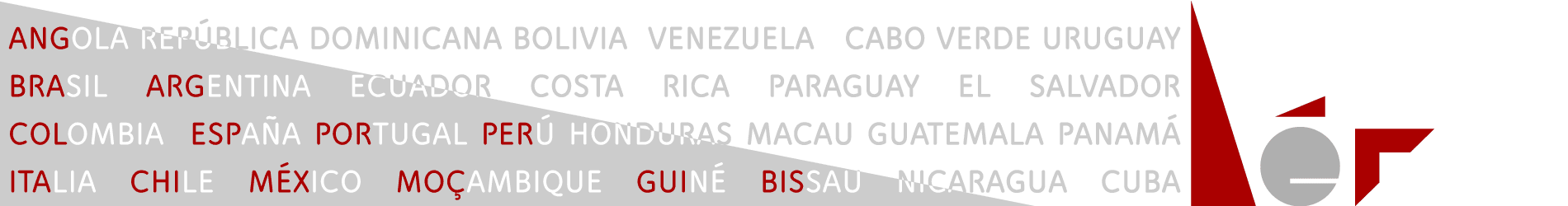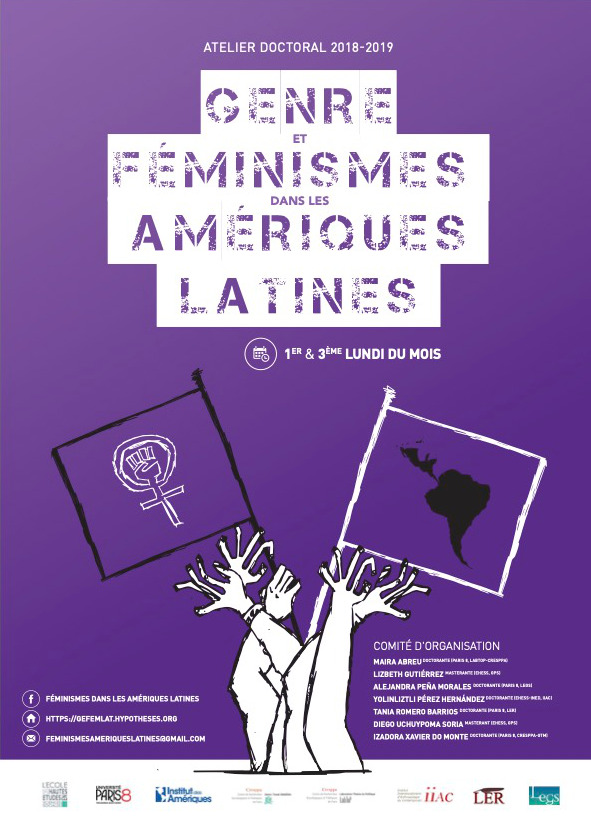2018-2019. Atelier doctoral. Genre et féminismes dans les Amériques latines
Atelier doctoral 2018-2019
Genre et féminismes dans les Amériques Latine
La cause féministe a de multiples voix. Si le mouvement féministe est indubitablement international, il émerge et s’enracine dans des contextes sociaux particuliers et se constitue en dialogue avec les traditions politiques et théoriques locales. Les féminismes latino-américains ont leurs propres voix et voies. Nés dans des contextes marqués par des cultures et des sociétés autochtones, par la colonisation, par leur position périphérique dans le système capitaliste, entre autres, ils se sont structurés, malgré les ressemblances avec leurs homologues en Europe et en Amérique du Nord, de façons diverses. Ils ont donc une histoire, avec des dynamiques et des chronologies qui leur sont propres.
Les études de genre en Amérique latine ont aussi parcouru des chemins qui leur sont spécifiques. Elles se développent depuis quelques décennies dans plusieurs pays de cette région. De nombreuses enquêtes et travaux ainsi que des centres de recherches et des revues spécialisées ont vu le jour dans les trente dernières années. Quelques-unes de ces réflexions arrivent en France mais de façon encore marginale. Depuis les années 1970, il existe en France des travaux portant sur le genre et l’Amérique latine, bien que ce ne soit pas toujours formulé dans ces termes. Par ailleurs, des étudiant.e.s latino-américain.e.s mènent de plus en plus leurs travaux dans ce pays sur ces questions.
Malgré le grand nombre de chercheuses et de chercheurs travaillant sur ces thématiques, les espaces de discussion et d’échange sur ces sujets en France restent rares. L’atelier Genre et féminismes dans les Amériques latines a pour but de faire connaître les problématiques, les propositions théoriques, les expressions et les mobilisations provenant de cette région du monde, ceci en vue de créer un espace de discussion pluridisciplinaire entre les sciences sociales, les sciences humaines et les arts. Il se propose aussi de promouvoir les échanges entre les pensées féministes hispanophones et lusophones des Amériques latines et celles qui sont nées dans d’autres aires et contextes. Nous cherchons par ailleurs à rassembler des chercheur.se.s et des militant.e.s, dans le but de créer un dialogue de savoirs produits à partir de différentes positions. Nous envisageons également de problématiser les vécus des femmes et des minorités de genre latino-américain.e.s en France, leur engagement dans un militantisme féministe et LGBTI* (à l’étranger), et la répercussion de celui-ci dans leurs recherches menées en France.
Lors de cette deuxième édition, nous aborderons des sujets tels que l’artivisme, les mobilisations collectives, les études trans ou encore les rapports à la religion, n’ayant pas encore été abordés dans le programme de l’année précédente.
L’atelier est ouvert à toute personne intéressée par les thématiques traitées. Celui-ci aura lieu le 1er et le 3ème lundi du mois de 18h à 20h, principalement à l’EHESS en salle AS1_23 (54 bd Raspail 75006) et ponctuellement à l’Université Paris 8 (2, rue de la liberté 94300), l’INALCO (65, rue des grands moulins 75013) et l’Institut des Amériques (60, boulevard du Lycée, 92170).
Carnet Hyphothèses : https://ameriques.hypotheses.org
Comité d’organisation :
Maira ABREU, doctorante (Paris 8, Labtop-CRESPPA)
Lizbeth GUTIÉRREZ, masterante (EHESS, GPS)
Alejandra PEÑA MORALES, doctorante (Paris 8, LEGS)
Yolinliztli PÉREZ HERNÁNDEZ, doctorante (EHESS-INED, IIAC)
Tania ROMERO BARRIOS, doctorante (Paris 8, LER)
Diego UCHUYPOMA SORIA, masterant (EHESS, GPS)
Izadora XAVIER DO MONTE, doctorante (Paris 8, CRESPPA-GTM)
Programme
Séance 1. 6 novembre 2018, 17h-19h
Paris 8 : 2, rue de la liberté 93200. Amphi B106
TABLE RONDE : ÉCHANGES AUTOUR DU GENRE, DES FÉMINISMES ET DES SEXUALITÉS ENTRE LES AMÉRIQUES LATINES ET LA FRANCE *
Lissell Quiroz, MCF en civilisation latino-américaine (Université de Rouen, ERIAC)
Jules Falquet, MCF HDR en sociologie (Paris 7, CEDREF-LCSP)
Mercedes Yusta, PR en histoire contemporaine de l’Espagne (Paris 8, LER)
Séance 2. 19 novembre 2018, 18h-20h
INALCO : 65, rue des grands moulins 75013. Salle 3.03
GENRE, TRAVAIL MINIER ET MILITANCE ÉCOLOGIQUE *
Kyra Grieco, docteure en anthropologie et ethnologie (EHESS, CERMA)
Caroline Weill diplômée en sciences politiques (IEP Strasbourg)
Co-organisation : projet ANDES-INALCO
Séance 3. 3 décembre 2018, 18h30-20h30
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
TRAVAIL INVISIBILISÉ DES FEMMES : LES CAS DU CARE AU CHILI ET DU MONDE CARCÉRAL AU PÉROU
Sebastián Pizarro, doctorant en sociologie (CNRS-LISE)
Sharie Neira, masterante en sociologie, spécialité genre (Paris 7)
Séance 4. 17 décembre 2018, 18h-20h
Institut des Amériques : 60 bd du Lycée 92170. Salle RDC
GENRE ET MILITARISATION AU BRÉSIL : PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DU FILM MANDADO DE BRENDA MELO MORAES ET JOÃO PAULO REYS *
Izadora Xavier, doctorante en sociologie (Paris 8, CRESPPA-GTM)
Co-organisation : association Alerta Feminista
Séance 5. 7 janvier 2019, 18h-20h
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
VERS UNE DÉCOLONIALITÉ CORPORALE
Lorena Souyris, post-doctorante en philosophie (ENS, LEGS)
Séance 6. 21 janvier 2019, 18h30-20h30
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
GENRE, APPORTS CRITIQUES À LA RELIGION ET FORCES CONSERVATRICES
Luis Martínez, post-doctorant invité au Collège d’études mondiales (FMSH-Paris)
Victor Hugo Ramírez García, doctorant en démographie (Paris 1, CRIDUP)
Séance 7. 4 février 2019, 18h-20h
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
GENRE ET ESPACE PUBLIC EN COLOMBIE
Samantha Joeck, doctorante en anthropologie (EHESS, CERMA-LAS)
Séance 8. 18 février 2019, 18h30-20h30
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
TRANSFÉMINISMES DANS LES AMÉRIQUES LATINES**
Mar Fournier Pereira, doctorant en philosophie (Lille 3, CECILLE)
Karine Espineira (PARIS 8, LEGS, co-fondatrice de l’Observatoire des Transidentités (ODT))
Séance 9. 4 mars 2019, 18h-20h
Paris 8 : 2, rue de la liberté 93200. Amphi X
PROJET ARTISTIQUE : MUSÉE ITINÉRANT MÉMOIRES DU CORPS FÉMININ (PÉROU-MEXIQUE-FRANCE)
Ana Villafana, artiste et diplômée en arts plastiques (Paris 1)
Gisela Romero, artiste et médiatrice culturelle
Cecilia Rejtman, artiste
Fedra Gutiérrez, artiste et masterante en danse (Paris 8)
Séance 10. 18 mars 2019, 18h30-20h30
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
TRAVAIL DU SEXE DANS LES AMÉRIQUES LATINES
Pascale Absi, chargée de recherche (IRD - CESSMA)
Séance 11. 1 avril 2019, 18h-20h
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
FEMMES AUTOCHTONES ET PARTICIPATION POLITIQUE CHEZ LES RUNA DE PASTAZA (AMAZONIE ÉQUATORIENNE)
Mariana Guanabara, doctorante en anthropologie sociale et ethnologie (EHESS, GSPM)
Séance 12. 15 avril 2019, 18h-20h
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
DERECHOS HUMANOS Y EL CASO DE LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS***
Julieta Chaparro-Buitrago, doctorante en anthropologie (Université de Massachusetts, Amherst)
Virginie Rozée, chargée de recherche (INED)
Séance 13. 6 mai 2019, 18h-20h
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
INTERSECTIONNALITÉ DANS LE QUILOMBO DE BEATRIZ NASCIMENTO (BRÉSIL)
Bruna Martins Coelho, doctorante en philosophie (Paris 8, LLCP)
Séance 14. 20 mai 2019
Paris 8 : 2, rue de la liberté 93200. Amphi X
RÔLE DES BATUCADAS DANS LA LUTTE FEMINISTE
Guarichas Cósmikas : batucada lesbo-trans-féministe
Séance 15. 3 juin 2019, 18h-20h
EHESS : 54 bd Raspail 75006. Salle AS1_23
SÉANCE FINALE ET POT DE CLÔTURE
* Séance suivie d’un pot sororidaire
** Séance en espagnol
Café-Amériques 14
Conflit armé au Pérou : genre et politiques de la mémoire
Présentation des livres par les auteures
Mardi 04 juin 2019 de 19h à 21h
INALCO | Salle 3.13 | Entrée libre
Femmes en armes. Itinéraires de combattantes au Pérou (1980-2000)
PUR. Collection "Des Amériques". 2019.
Proposant de dépasser l’effet de cristallisation qu’inspire l’image de la militante sendériste, cet ouvrage rend compte des multiples facettes de l’expérience combattante féminine. En retraçant différents itinéraires de vie de femmes ayant pris les armes pendant le conflit armé il illustre les grands bouleversements ayant marqué la société péruvienne et offre un nouvel éclairage sur les moteurs de la violence politique. L’analyse de l’expérience combattante féminine ainsi présentée rompt avec les approches classiques sur la guerre et les conflits armés, en situant les rapports de genre au cœur de sa problématique.
Camille Boutron est sociologue féministe et chercheuse à l’Institut des études stratégiques de l’École militaire (IRSEM). Ses travaux portent sur la participation des femmes aux conflits armés, la féminisation des institutions militaires, ainsi que sur les politiques du genre dans le cadre de la paix et de la sécurité.
Sur les sentiers de la violence. Politiques de la mémoire et conflit armé au Pérou
Éditions de l’IHEAL. Collection "Travaux et mémoires". 2019.
Valérie Robin Azevedo s’est intéressée aux bricolages sémiotiques qui permettent aux communautés quechuas, les plus éprouvées par la guerre, d’évoquer la violence. Influencées à la fois par un discours hérité de la Commission de la vérité, mais aussi par l’imaginaire culturel andin, ces configurations inédites forment autant de chemins de traverses dans la quête d’un vivre ensemble apaisé. Décalées par rapport au modèle prôné par la justice transitionnelle, les dynamiques mémorielles analysées sont peu visibles dans l’espace public national. Pourtant, elles révèlent la valeur symbolique et sociale des procédés alternatifs de gestion du passé en contexte post-conflit. Sur les sentiers de la violence constitue à ce titre un essai original d’anthropologie des mémoires de guerres civiles.
Valérie Robin Azevedo est professeure d’anthropologie à l’université Paris- Descartes et dirige le Centre d’anthropologie culturelle (CANTHEL). Chercheuse associée à l’Institut français d’études andines (lFEA), elle enseigne aussi dans le diplôme de langue et culture quechuas de l’lNALCO. Elle a notamment publié les ouvrages Retour des corps, parcours des âmes. Exhumations et deuils collectifs dans le monde hispanophone, avec A.-M. Losonczy (2016), El regreso de lo indígena. Retos, problemas y perspectivas, avec C. Salazar (2009), Miroirs de l’Autre vie. Pratiques rituelles et discours sur les morts dans les Andes de Cuzco, Pérou (2008).
Lieu : INALCO (65, rue des Grands Moulins 75013, Paris - salle 3.13)
Pour plus d’informations : https://ameriques.hypotheses.org